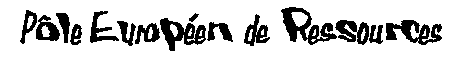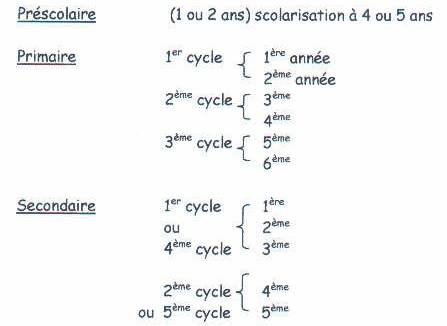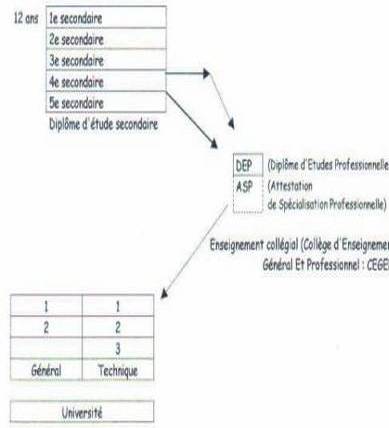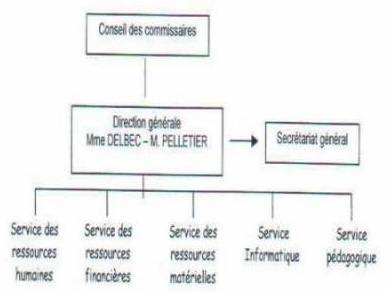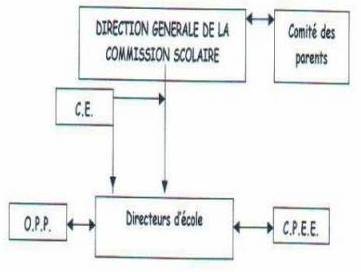| Organisation
administrative de l’éducation au Québec Organisation
de l'Enseignement
Dans le langage courant, on
parle de première secondaire, deuxième
secondaire, etc.
Collèges
d’Enseignement Général et Professionnel
Schéma
du système éducatif québécois
École
primaire
Enseignement
secondaire
A noter :
Sous une apparente simplicité existe une grande
variété de "parcours diversifiés"
dès la fin de l'école primaire en fonction des
acquis réels des élèves. On peut trouver des
"années intermédiaires" et des
parcours parallèles mis en oeuvre par les
écoles elles-mêmes.
MINISTERE DE
L’EDUCATION (Direction Régionale)
Présentation
de la structure
Les
Directions Régionales correspondent, en terme de
compétences, approximativement à nos Rectorats.
Il en existe 11 qui couvrent 17 régions.
C’est le canal privilégié de l’action
du Ministère en Région. Elles servent à
véhiculer et promouvoir les orientations du
Ministère auprès des organismes scolaires
responsables de l’éducation préscolaire et
de l’enseignement primaire, secondaire,
collégial et universitaire.
Le système éducatif
québécois est en cours de réforme. Une
nouvelle loi sur l’Instruction Publique a
été appliquée dès septembre 1998. C’est
une loi centrée sur l’élève.
Elle aborde différents
domaines :
-
Les élèves
(droits et devoirs)
-
Les
conseils d’établissement
-
Les
enseignants
-
Le
rôle des directeurs d’école
-
La
place des parents
-
Les
commissions scolaires
-
Les
centres éducatifs
-
Le
rôle du Ministère de l’éducation
Cette loi
apporte des modifications sur les programmes du
primaire et du secondaire. Le changement
important concerne surtout la mise en place de
commissions scolaires linguistiques. Au lieu
d’être catholiques ou protestantes, les
commissions scolaires sont francophones ou
anglophones. La loi a réduit le nombre de
commissions : de 156, les commissions sont
passées à 72 :
La loi
redéfinit les pouvoirs aux différents paliers
de l’administration scolaire. C’est un
renversement de tendances : la loi est
centrée sur la réussite des élèves, elle
donne une place importante aux parents, elle
définit les commissions scolaires sur une base
linguistique et non plus confessionnelle.
Missions
Fonctions
régulières et récurrentes
-
service
à la population et aux organismes
scolaires (accueil, renseignements,
recherche, avis, conseils…),
-
représentation
auprès des partenaires et relation avec
les médias,
-
contrôle
des effectifs jeunes et adultes,
-
promotion
des priorités annuelles du Ministère,
mise en contexte selon les
particularités régionales, mise en
œuvre et réunion des interlocuteurs
touchés
Coordination
régionale
| |
- production
d’avis sur des politiques,
des programmes, des ententes, des
plans d’action, etc. en
provenance des autres Ministères
et sensibilisation des
interlocuteurs aux besoins des
réseaux de l’éducation et
aux services offerts dans ces
réseaux,
|
| |
- harmonisation
des politiques, des programmes,
des services gouvernementaux en
Région.
|
Contribution au
développement régional
La
formation initiale et continue des enseignants se
fait à l’université. La formation continue
est prise en charge par l’université en
collaboration avec les commissions scolaires.
La
formation initiale dure 3 ans, plus un an de
stage. Onze compétences sont requises. Les
enseignants sont formés sur un champ
disciplinaire.
La
formation continue : les professeurs
expriment des besoins de formation. La commission
scolaire approuve ce plan de formation. Il est
prévu, sur 200 jours de travail, 180 journées
d’enseignement et 20 journées pédagogiques
dont les journées de formation.
A
noter : les compétences de cette
institution doivent s'analyser en regard d'une DÉCENTRALISATION
du système, dans laquelle les usagers
reçoivent la plus grande partie du pouvoir.
Exemple :
Direction
Régionale de la Capitale Nationale et
Chaudière-Appalaches
-
située
à Québec, cette Direction correspond à
une région comprenant Québec et la rive
sud du Saint-Laurent, soit environ 600
000 habitants ;
-
les
fonctions sont assurées par 13
personnels administratifs dont la
Directrice (ils étaient 59 au départ,
puis 21 en 1995 suite à une compression
de personnel importante dans tous les
services de l’éducation, et surtout
à un transfert de compétences vers les
commissions scolaires (élèves).
Personnes
ressources
-
Gilles
MARCOUX, Spécialiste en Sciences
Humaines
-
Sylvie
DESCOTEAUX, Directrice de la Direction
Régionale
Site web :
http://www.meq.gouv.qc.ca
MINISTÈRE
DE
L’ÉDUCATION (Commission
Scolaire)
Présentation de la
structure
-
Structure
intermédiaire entre le Ministère de
l’Education du Québec et
l’école proprement dite,
administrée par un Conseil de
Commissaires, élus au suffrage
universel, pour une durée de 4 ans, et
de représentants des parents nommés
pour 1 année.
-
Elle
regroupe les écoles publiques, les
centres d’éducation des adultes et
les centres de formation professionnelle.
-
72
commissions scolaires sont dénombrées
au Québec, dont 60 francophones, 9
anglophones et 3 à statut particulier,
situées sur les secteurs géographiques
déterminés.
-
L’autorité
relative aux règlements et aux lois
appartient au Conseil des commissaires.
Le pouvoir exécutif est du ressort du
Comité exécutif ou de la Direction
Générale de la Commission Scolaire.
-
Cette
institution, DÉCENTRALISÉE, exerce des
compétences de recrutement,
d'encadrement et d'appui pédagogique.
Missions et
mandats
-
Organiser
et prodiguer des services éducatifs pour
des établissements d’enseignements
préscolaire, primaire et secondaire
d’un territoire donné :
services d’enseignement et
péri-scolaire (garderie, transport,
services aux élèves handicapés ou en
difficulté, d’adaptation et
d’apprentissage, restauration et
hébergement)
-
Le
Directeur Général, élu à la tête de
chaque commission, s’occupe de la
gestion des écoles et nomme les
Directeurs d’école après avoir
consulté le Conseil
d’établissement de l’école.
-
Formation
continue et inspection des enseignants.
-
Répartition
des fonds monétaires entres les écoles
dépendantes de la Commission.
Ressources et
budgets
| |
- Subventions
gouvernementales : 80%
- Impôt
foncier scolaire : 15%
- Divers :
5%
|
Exemple :
Commission Scolaire des Découvreurs
(Québec)
-
14
000 élèves du préscolaire à la
cinquième secondaire et 2 000 adultes,
soit 60 écoles, 3 centres de formation
professionnelle et 2 centres
d’éducation pour adultes
-
1 500
personnes employées dont 900 enseignants
et 60 personnes au siège social.
Personnes
ressources
Chantal DOLBEC, Directrice générale de la Commission
Scolaire des Découvreurs ;
André
PELLETIER, Directeur général Adjoint de la
commission scolaire des Découvreurs
Organisation
administrative des commissions scolaires
Exemple
: Commission scolaire des Découvreurs
La Commission scolaire des
Découvreurs (banlieue de Québec) s’occupe
de 16 000 élèves dont 14 000 élèves
du préscolaire à la 5ème secondaire
et 2 000 adultes. Le milieu est plutôt favorisé
(quartiers autour de l’aéroport Ste-Foix).
On prévoit une légère baisse d’effectifs
de 10 à 20 %. Aussi, des initiatives sont-elles
prises pour rendre attractives les écoles
(projets innovants, publicité, journée portes
ouvertes). La commission des découvreurs se
place en tête en matière de
" diplomation ".
La
commission emploie 1500 personnes dont 900
enseignants. 60 personnes travaillent au siège
social.
La
commission scolaire des découvreurs
s’occupe de :
Relation
commissions scolaires-écoles
C.E. :
Conseil d’Établissement
avec pouvoirs décisionnels et pouvoirs
de recommandation.
Composition :
-
O.P.P. :
Organisme de Participation
des Parents.
-
Comité
de Parents : 1 représentant
par école, rôle consultatif.
-
C.P.E.E. :
Comité de Participation
des Enseignants à l’École,
consulté éventuellement par le
Directeur pour des problèmes
pédagogiques.
MINISTÈRE
DE
L’ÉDUCATION
Établissements d’enseignement primaire et secondaire
Présentation de la
structure
-
L’école
est définie comme établissement
d’enseignement primaire et
secondaire.
-
L’ouverture
d’une école est décidée par la
commission scolaire et placée sous
l’autorité d’un conseil
d’établissement.
-
Chaque
directeur d’école, qui occupe un
poste à temps complet, est nommé par la
commission scolaire.
Missions
Les
services éducatifs offerts aux élèves du
pré-scolaire, du primaire et du secondaire
comprennent des services d’enseignement, des
services complémentaires et des services
particuliers définis dans les régimes
pédagogiques adoptés par le gouvernement.
1) Les
services d’enseignement
2) Les
services complémentaires :
-
ils
ont pour but de favoriser la progression
continue des élèves à l’école en
assurant un soutien aux divers services
offerts, en contribuant au développement
de l’autonomie des élèves, de leur
sens des responsabilités, etc.,
-
ils
prennent des formes diverses :
services spécialisés d’aide et de
soutien, services d’orthophonie, de
psycho-éducation et d’éducation
spécialisée, services sociaux et de
santé, participation des élèves à la
vie éducative, éducation au droit et
aux responsabilités et aussi services
d’animation catholique et
protestante…
3) Les
services particuliers :
-
Pour
les élèves en difficulté :
services d’orthopédagogie,
cheminements particuliers de
formation…
-
Pour
les nouveaux arrivants :
services d’aide à
l’intégration scolaire et sociale,
services d’accueil, encadrement
pédagogique et organisationnel accru
dans les milieux à forte concentration
ethnique…
-
Pour
les élèves scolarisés à domicile ou
en milieu hospitalier.
-
Pour
les élèves issus de milieux
défavorisés : mesures
spéciales de soutien, maternelle 4 ans
à mi-temps, soutien alimentaire, aide
aux travaux scolaires…
-
Pour
les élèves des communautés
autochtones.
Exemple :
École Dominique SAVIO (Québec)
Située en
zone défavorisée, elle reçoit des populations
immigrées, multi-ethniques.
-
300
élèves de la maternelle (dont des
maternelles 4 ans) à la sixième année
primaire.
-
Personnels :
enseignants, 1 éducateur spécialisé
pour les élèves en difficulté et
soutien aux enseignants, 1 psychologue,
des spécialistes disciplines (EPS,
anglais, musique), 1 infirmière, 1
orthopédagogue et beaucoup de parents
bénévoles (qui gèrent entre autre une
bibliothèque de 5000 livres).
Réalisations :
-
Tous
les élèves doivent s’inscrire à
l’école française sauf ceux qui
ont un "permis" pour
s’inscrire dans une école
anglophone. Pour avoir ce droit, il faut
avoir fréquenté l’école primaire
en anglais.
-
Les
immigrés ne sont pas, semble-t-il, un
problème au Québec. Ils sont intégrés
et pris en charge selon leur nombre soit
dans des classes d’accueil, soit
dans les classes régulières. La mesure
d’accueil peut durer 3 ans.
-
Les
élèves immigrés sont intégrés dans
les classes (56 élèves sur 300) et
reçoivent un soutien en langue
française pendant deux ans, à raison de
deux périodes par semaine, par groupe de
deux de même niveau.
-
Chaque
enfant reçoit un document appelé
" bonjour ",
essentiellement ludique et imagé, dont
il peut se servir avant même de
connaître la langue. L’informatique
est beaucoup utilisée (laboratoire de 20
pentiums et 1 ordinateur par classe).
-
Chaque
élève dispose d’un passeport
éducatif relatif aux règles de vie
(voir annexe)
Personne
ressource
Monsieur
TARDIFF, Directeur de l’école.
E-mail :
ecole.dsavio-maiz@cscapitale.qc.ca
Quelques réflexions
Les
différents interlocuteurs que nous avons pu
rencontrer ont tous insisté sur les
transformations en cours dans le système
éducatif québécois. Elles ont été assez bien
résumées par le Directeur Général Adjoint de
la Commission Scolaire des découvreurs.
1 - De
l’accessibilité au succès
Avant la
réforme, l’objectif de l’Education
était la démocratisation, l’accès à
l’école pour tous, aujourd’hui il faut
viser la réussite de tous.
2 - De
l’unicité à la diversité
L’enseignement
dispensé était le même pour tous. A présent,
la demande des familles est importante, les
écoles veulent répondre à cette demande en
offrant des parcours diversifiés.
3 - De
la centralisation à la décentralisation
Les
écoles sont de plus en plus autonomes dans leur
choix de projet, confrontées à la double
pression des familles et des commissions élues.
4 - De
l’ego au réseau
Les
écoles sont en concurrence les unes avec les
autres. Elles veulent offrir le meilleur des
équipements et le maximum d’options. Aussi,
de plus en plus d’écoles recherchent-elles
des partenaires et même des sponsors.
5 - De
l’info au savoir
Devant la
multiplicité des informations et des
connaissances, l’objectif devient davantage
d’apprendre à savoir (savoir être,
savoir-faire).
Ces
" principes " ressemblent
beaucoup à ce que notre système éducatif, et
plus largement les systèmes européens, sont en
train de connaître. Toutefois les Québécois
semblent avoir franchi des étapes
supplémentaires et il peut être intéressant de
reprendre thème par thème en les reliant à
notre expérience et à nos propres évolutions.
6 - De
l’accessibilité au succès
La
démocratisation doit suivre nécessairement la
massification et tous les systèmes des pays
développés sont aujourd’hui confrontés à
l’exigence de " qualité
totale ". La question est de savoir
quelle est la mesure du succès. Le pragmatisme
Nord-Américain insiste sur le diplôme, et
l’insertion professionnelle. Depuis quelques
années nous suivons le même chemin et nul ne
saurait refuser la nécessité de préparation à
l’emploi. Toutefois cet objectif, très
utilitariste, difficile à tenir
" directement " de surcroît,
ne laisse plus de place au " plaisir
d’apprendre ". Même si celui-ci
apparaît d’essence élitiste il est
indispensable pour que les élèves vivent
l’école de manière positive et pas
seulement sous la contrainte, avec un
hypothétique espoir d’insertion. C’est
là probablement le défi majeur pour notre
école.
7 - De
l’unicité à la diversité
S’adapter
à chaque élève, mettre les élèves au centre
du système éducatif… Toutes choses que
nous efforçons de faire. Toutefois une analyse
un peu plus approfondie de ce que nous avons vu
montre que cela peut se faire au prix d’une
" exclusion douce " avec
différentes filières, différents dispositifs
d’aide ou de soutien qui écartent peu à
peu l’élève du cursus normal. Principe de
réalisme probablement, que nous pratiquons
aussi, mais jusqu’où peut-on et doit-on
pousser le " Tronc commun "
d’une école démocratique et à quel
prix ?
Ces deux
questions se rejoignent et nous connaissons la
même évolution, même si nous ne sommes pas
– encore – parvenus au même point. Il
est clair aujourd’hui que le pouvoir
scolaire au Québec est passé du côté des
utilisateurs, les parents. On peut certes en
souligner les risques : soumission des
enseignants, ghettoïsation de certaines
écoles…(ce qui est déjà avéré aux
Etats-Unis par exemple) mais nous ne pouvons
l’ignorer, ceci est devant nous.
Il est
difficile, impossible, de transférer d’un
système à l’autre sans modifications, et
notre histoire scolaire rend très improbable un
tel point d’arrivée. Mais la pression
existe et la place des utilisateurs va augmenter.
Ce qui est
ici intéressant c’est de noter comment les
professionnels de l’école québécoise se
sont adaptés. Un axe est en train de se créer
entre les agents – Directeur Général et
cadres - des Commissions scolaires et les Chefs
d’établissement pour exister réellement
face aux commissaires élus et aux élus des
Conseils d’établissement. Dans le même
temps les services des commissions, et même des
directions régionales, ont peu à peu abandonné
leurs pratiques de direction pour se mettre au
service des établissements.
Il y a là
une évolution qui mériterait d’être
analysée et pourquoi pas, méditée dans nos
différentes instances.
De
l'info au savoir
Faut-il
commenter ? Mais pour nos hôtes québécois
comme pour nous cela pose la question de la
professionnalité des enseignants transmetteurs
de contenus, ou passeurs vers un apprentissage.
Force est de constater que nous avons là quelque
retard !
|