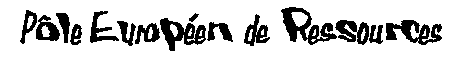Visites des
établissements scolaires dans la province du
Québec
(Polyvalents
Lucien Pagé et Henri Bourrassa)
Quelques
impressions consécutives aux nombreux entretiens
et questions échangés avec les enseignants et
responsables.
Il
semble d’abord qu’il faille éviter
toute tentation de transférer tels quels des
méthodes ou des dispositifs qui paraissent
pourtant très adaptés. Toute comparaison
directe entre la situation des deux systèmes
éducatifs (québécois et français) serait
dangereuse. En effet, les éléments de contexte
sont trop différents pour permettre des
transpositions immédiates.
1)
CONTEXTE
On
observe avec surprise et intérêt les très
fortes conventions morales et idéologiques ;
"ortho"
pressions relayées par divers moyens
–extrêmement variés et perceptibles- pour
démontrer aux élèves l’appartenance au
groupe et le partage de ses valeurs :
-
devoir,
-
bonheur,
-
réussite,
-
tableaux
d’excellence,
-
photos
de promotions en grand uniforme,
-
textes
référentiels (maximes, poésies…),
-
drapeau
québécois,
-
fanions,
-
etc.
On
observe avec surprise et intérêt les dimensions
et le confort certain des bâtiments
qui permettent à
chaque établissement (polyvalente) de disposer
d’un grand nombre de salles et
d’intégrer salles de spectacles, de
réunions, de réceptions, de gymnastique.
On
observe avec surprise et intérêt que la forte
présence des adultes pendant le temps de
cours et pendant les temps de battement,
contribuent à l’apaisement des
comportements collectifs et individuels des
élèves. Le temps de présence des enseignants
est de 24 heures par semaine y compris des heures
de surveillance dans les couloirs, des heures de
concertation…
2) PROCÉDURES
-
En
collectif, forte présence des adultes
dans l’espace et le temps scolaire
(conseillers d’orientation,
professeurs, déambulent, discutent avec
les élèves), temps de service 24
heures. Des dispositifs internes très
identifiés pour une saisie (type classe
relais en interne) immédiate de
l’élève : suspension dans le
" local de retrait ".
-
Mesures
d’appui : modules transitoires
de renforcement : français,
mathématiques. Cette action est possible
car les emplois du temps sont bâtis sur
des " briques
pédagogiques " construites sur
quatre séquences par jour (75 minutes)
sur 9 jours réguliers : cheminement
particulier, redoublement (1 an
d’écart maximum) avec une
différence de niveau d’un an dans
une discipline fondamentale.
-
Agenda :
travail très fort, fait à partir
d’un document unique qui est
à la fois outil méthodologique,
échéancier, livre de bord, carnet de
maximes, aide mémoire et guide de
renseignements divers. L’agenda doit
toujours être sur l’élève
et peut être support de va et vient avec
les adultes (enseignants,
surveillants...).
-
Le
local de retrait : sorte de
salle de retenue à très faible effectif
(5, 6 élèves) isolés matériellement
les uns des autres. L’élève est
envoyé pour comportement irrespectueux
ou improductif par le professeur de la
classe qui écrit sur une fiche de
liaison les raisons claires du renvoi de
l’élève ; celui-ci doit
durant son séjour dans le local de
retrait comprendre pourquoi il a été
renvoyé et proposer comment il pourrait
faire pour avoir un autre comportement.
Ce travail doit être rendu par écrit
et l’adjoint de direction fait la
médiation avec le professeur.
-
Inter
connexion des personnels de surveillance
et des personnels de direction par un
système de téléphones portables
interne qui permet un traitement en temps
réel des difficultés, une concertation
et une formation dans l’urgence.
3) PROJET
PEDAGOGIQUE
a)
Interne éducatif : budget a priori
(rôle très important des vérificateurs) qui
permet une très grande souplesse
d’utilisation de fonds (publics et privés)
pour réaliser des actions transversales ou
parascolaires.
b)
Externe éducatif : environnement
communautaire, c’est à dire partenariat
associatif qui peut intervenir dans
l’établissement avec des élèves
consentants et orientés par les enseignants.
Exemple :
le GIPEC (groupe d’interventions
pédagogiques et communautaires) dans
l’école polyvalente Lucien Pagé ;
horaire régulier 8h30-15h30, le partenariat
organise dans l’établissement des
activités d’aide aux devoirs, des
activités sportives, culturelles.
c) Forte
référence en psychologie de
l’apprentissage et du comportement,
(tendance fonctionnaliste) et pédagogie par
objectifs :
-
(10 %
des élèves inscrits dans le
" cheminement
particulier " peuvent
raccrocher le cursus ordinaire sur un
effectif de 230 élèves inscrits dans ce
cheminement pour un effectif global de
1900). Chaque
établissement dispose d’enseignants
ressources "formation
orthopédagogue" qui vient en aide
aux professeurs pour établir un meilleur
contact avec les jeunes élèves :
organiser leur agenda, comment faire les
devoirs, comment arriver à l’heure.
Ils organisent des parrainages entre
élèves plus âgés avec les plus
jeunes, augmentation de l’estime
personnelle, donne une nouvelle
confiance, motive pour la réussite
scolaire. Ils agissent sur la
préparation des examens, la gestion de
l’information, l’organisation
de la mémoire, les techniques
d’apprentissage.
Lorsque
plusieurs enseignants signalent le même élève,
une fiche d’appréciation de l’élève
est donnée à tous les enseignants, pour
qu’ils construisent un profil du jeune,
l’orthopédagogue fait un compte rendu de
synthèse qu’il donne aux enseignants et au
techniciens de rééducation.
4) ACCUEIL DES
MIGRANTS
Le
dispositif existe dans tous les établissements
de l’Ile du Mont Royal en relation avec la
politique d’immigration du gouvernement
québécois. Le principe repose sur des
éléments fixes :
-
Bureau
d’admission (contrôle légal) et
accueil-bilan : les québécois
soulignent que en plus de l’écart
scolaire et culturel, il existe aussi un
fort écart social et familial lors de
l’arrivée des jeunes migrants ;
souvent la migration s’accompagne
d’une séparation de plusieurs
années avec une partie de la cellule
familiale ; ajouté à la
précarité économique, ce facteur est
pris en compte par les travailleurs
sociaux grâce à un accompagnement
global dans lequel s'insère celui
réalisé par les enseignants.
-
Après
ce bilan accueil, l’élève est
renvoyé vers l’école du quartier
de résidence. Il effectue 10 mois dans
une classe SAS : 36 périodes dont
24 en français, 8 périodes en
mathématiques, 4 périodes ouvertes. Ces
48 périodes sont assurées par des
enseignants français langue seconde (4
professeurs).
En sortie,
soit :
-
transfert
vers le droit commun (régulier ou
cheminement particulier),
-
post
accueil (plus x périodes suivant les
besoins),
-
accueil
suivi 12 groupes de 16 jeunes viennent
autant que de besoin bénéficier
d’un soutien individualisé.
Comme en
France, la migration est de plus en plus marquée
par une arrivée d’élèves de plus en plus
non scolarisés dans le pays d'origine (88
nationalités différentes dans l’école, 8
traducteurs médiateurs). D’un certain point
de vue, ce très grand nombre des langues de pays
d’origine, oblige ces élèves à parler
entre eux la langue du pays d’accueil :
le français.
Ce modèle
fonctionne depuis une quinzaine d’années et
paraît donner satisfaction ; il permet à plus
de la moitié d’entre eux de revenir au
cursus régulier.
5)
PARTICULARISMES
-
Québec :
le système éducatif est complètement
indépendant du niveau fédéral.
L’identité québécoise,
francophone, est minoritaire dans un
contexte anglo-américain très
preignant ; cette identité est
très fortement revendiquée et constitue
un moteur dynamique de développement.
Envie et besoin de parler, de
s’exprimer en français dans une
différence qui est une fierté.
-
Importance
de l’enseignement de
l’histoire, du patrimoine.
C’est un des trois éléments qui
constitue le module d’accueil
scolaire des migrants (tout comme dans un
autre ordre d’idées, la place
reconnue, à l’école, de
l’enseignement religieux, moral). On
ressent une approche soucieuse de partir
du vécu et des préoccupations sociales
en matière de vie quotidienne, de
communication, de relations adaptées.
-
Intervention
des groupes associatifs (dits
communautaires) qui sont
fonctionnellement liés à
l’enseignement.
-
L’identité
professionnelle des enseignants est plus
large (plus éducationnelle que
transmissive). Les professeurs ont des
heures de surveillance.
Toute
personne a une importance ; la hiérarchie
n’est pas prioritaire. Travail
d’équipe, respect des élèves, amour des
élèves, démontrer que le respect a une place
dans la vie.
Exemples :
-
Un
adulte (enseignant, technicien de
service…) qui circule dans
l’école demandera à un élève de
lui montrer son agenda, si l’élève
refuse, une action est immédiatement
mise en place.
-
Un
élève était couché sur un banc, la
conseillère lui demande de se lever, il
l’écoute et s’assoie, ce
n’est pourtant pas un personnel de
direction.
Chaque
personne de l’école est invitée à suivre
une formation d’une demi-journée sur la
gestion de groupe, les crises et comment réagir
en cas de crise. Comment intervenir à son
niveau, y compris des formations interventions au
niveau du comportement physique à tenir en cas
de violence.
Paradoxes
: certaines fonctions (orthopédagogues,
travailleurs sociaux, rééducateurs) sont
embauchées à titre précaire (sous forme de
contrat à 10 mois) la pression idéologique et
sécuritaire est très marquée (trop ?) à
l’intérieur de l’établissement alors
que à l’extérieur on sait
l’organisation des gangs de rue, la
consommation et le trafic de toxiques.
6) PROJETS
POSSIBLES
a)
Opérationnaliser tout ce qui semble
transférable.
b)
Construire :
c) Problématiques :
-
Identité, appartenance, insertion
personnelle et collective dans un espace
culturel minoritaire (avec des exemples).
-
Fonctionnement public et aide par
fondations privées ; le rôle des
financeurs et des coopérateurs pour la
réussite scolaire.
-
Articulation système
éducatif/interventions
communautaire ; le scolaire et le
para scolaire.
-
Modules d’accueil des jeunes
migrants, aspect social, culturel,
familial, scolaire.
Groupe
d'Interventions Pédagogiques et Communautaires
(GIPEC)
-Polyvalente
Lucien Pagé-
1 - OBJECTIFS
Promouvoir
et favoriser la réussite scolaire et le
développement social des élèves en difficulté
d'apprentissage.
Cent
élèves à haut risque d'échec scolaire, de
1ère et 2ème secondaire, ont été
sélectionnés.
Comme le
nom GIPEC l'indique, les interventions sont de
deux types : pédagogiques et communautaires. Une
organisation considérable a été mis en place ;
avec l'accord des parents, de 15h30 à 17h30
trois jours par semaine, l'école continue à
vivre au même rythme fébrile que durant la
journée.
2 - DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS
Chaque
rencontre se divise en trois temps :
-
Collation.
-
Travaux
scolaires assistés par des étudiants
universitaires en pédagogie.
-
Activités
organisées par divers organismes
communautaires :
|
|
-
culturelles
(théâtres, danse,
improvisation),
-
sportives
(basket-ball, soccer),
-
technologiques
(informatique et Internet),
-
ateliers
portant sur l'estime de soi,
-
ateliers
d'information à la formation
professionnelle.
|
Tout ce travail se fait avec
la complicité des enseignants et avec la
collaboration des parents.
Centre
Métropolitain de lutte au décrochage scolaire
1) LA FONDATION DU
CONSEIL SCOLAIRE DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
Créée en
1990, la fondation du Conseil scolaire de
l'île de Montréal est un organisme à but
non lucratif composé de représentants du monde
scolaire et du monde des affaires. Son
objectif : promouvoir la réussite éducative
des jeunes montréalais et encourager la
persévérance dans les études, notamment au
secondaire.
Dans le
but de concrétiser davantage ses interventions,
la Fondation publia, en 1993, une recherche
majeure sur l'abandon scolaire sur l'île de
Montréal, conduite par la Faculté d'éducation
de l'Université de Montréal. Cette recherche
donna lieu à la publication d'un plan d'action
intitulé "Chacun sa part". Ce
plan d'action recommandait la mise sur pied d'un
centre de référence où les jeunes et leurs
parents pourraient trouver certaines réponses à
des problématiques de décrochage scolaire.
Donnant
suite à cette recommandation, la Fondation
créa, à la fin de l'année 1994, le "Centre
métropolitain de lutte au décrochage
scolaire".
Grâce aux
fonds recueillis auprès de ses partenaires du
monde des affaires, la Fondation a engagé deux
éducateurs retraités à temps partiel et une
secrétaire pour organiser et faire fonctionner
le Centre.
2) CENTRE MÉTROPOLITAIN DE LUTTE AU DÉCROCHAGE
SCOLAIRE
Un
centre de référence et
d'aiguillage pour des jeunes et des parents qui
recherchent des services appropriés liés à la
persévérance scolaire des jeunes ou à un
retour aux études pour ceux et celles qui ont
décroché. Ces références se font par
communication téléphonique (384-1830, poste
252) ou par des entrevues individuelles. En
1995-1996, le Centre a répondu à 129 demandes
d'aide et en 1996-1997, a traité plus de 325
appels téléphoniques liés à la prévention du
décrochage ou au raccrochage des jeunes.
Un
carrefour d'échanges entre les
groupes engagés dans la lutte au décrochage
scolaire. Ces échanges épisodiques ont donné
lieu à la fondation du "Regroupement
d'organismes communautaires d'intervention en
décrochage scolaire". Incorporé en
janvier 1997, le Rocidec regroupe 16 organismes
qui oeuvrent dans le domaine.
Un
centre de documentation et d'information
en rapport avec les ressources existantes sur
1 île de Montréal ou en rapport avec l'aide que
le Centre peut éventuellement apporter aux
jeunes et aux parents qui connaissent des
difficultés liées au cheminement scolaire.
| |
En égard à cette
mission, le Centre a publié un
répertoire des principales ressources
scolaires et communautaires susceptibles
d'aider les jeunes à cheminer dans leur
scolarisation ou à effectuer un retour
aux études. De plus, le Centre
publie une à deux fois par année un
bulletin destiné à faire connaître des
projets innovateurs liés à la
prévention du décrochage ou au
raccrochage des jeunes.
Le
dernier bulletin du Centre était
destiné aux parents. Près de 250 000
exemplaires ont été distribués à
travers le Québec dont 200 000
exemplaires sur 1'île de Montréal, par
l'entremise de Québécor et du Journal
de Montréal.
Le
Centre publie aussi occasionnellement des
feuillets destinés aux jeunes
décrocheurs potentiels ou réels.
Parallèlement
à ces activités, le Centre procède, à
partir des données du Ministère de
l'éducation du Québec, à des études
statistiques sur l'évolution du
décrochage scolaire sur 1'île de
Montréal.
|
Organisme
communautaire "lettres en main"
Organisme
communautaire de Montréal créé en 1982
intervenant sur le champ de l'alphabétisation
populaire.
1 - Historique de
l'alphabétisation populaire
-
Des
"comités citoyens" demandent
auprès de la commission scolaire des
cours de français. Le problème
rencontré tient à l'inadaptation de ces
cours à des adultes.
-
Émergence de "l'alphabétisation
conscientisante" ( Paulo FREIRE
(1)) .
-
Création
de deux réseaux
d'alphabétisation :
| |
- les
commissions scolaires :
réponse institutionnelle
- les
organismes communautaires :
réponse militante, connaît un
plus grand succès.
|
Aujourd'hui
140
groupes d'alphabétisation populaire sont
inscrits dans le réseau populaire, mais restent
totalement autonomes (depuis 1980).
Dans ce
réseau il y a des assises et des objectifs
communs mais chaque structure reste
indépendante. Une charte recense 12 principes
fondateurs : considérer que
l'analphabétisme est un révélateur d'une
situation difficile plus large. Ainsi la solution
n'est pas uniquement dans l'apprentissage du lire
- écrire, autonomie de choix pédagogiques par
rapport aux commissions scolaires et les autres
financeurs, faciliter la participation des
apprenants (participants) aux orientations de
l'organisme dans lequel ils suivent des cours
d'alphabétisation.
Pour
intégrer le regroupement d'organismes
d'alphabétisation populaire un formulaire doit
être rempli.
Ainsi la
problématique de l'analphabétisme est perçue
différemment entre les commissions scolaires et
les organismes communautaires :
-
Les
commissions scolaires proposent une
réponse individuelle : diagnostic,
actions, interventions
professionnalisées voire anonymes.
-
Les
organismes communautaires
d'alphabétisation populaires
considèrent la situation
d'analphabétisme comme inscrite dans une
situation plus large et collective. Pour
eux la solution tient d'abord à leur
capacité à développer une relation.
D'ailleurs ils parlent de
"participants" pour ceux que
nous nous appelons
"apprenants". La solution doit
être également globale et pas
uniquement ciblée sur les apprentissages
(défendre les droits des analphabètes,
par ex. photo sur les bulletins de
votes).
2 - La place des
outils utilisés par les formateurs
C'est
pourquoi un même outil n'aura pas la même
saveur selon qu'il est utilisé par la commission
scolaire ou un organisme communautaire. En effet,
"l'outil n'est pas conscientisant mais c'est
la relation". Par exemple les animateurs
rencontrés nous expliquent l'importance qu'ils
accordent aux pauses pour amorcer, continuer une
relation et y trouver des supports appropriés
aux participants. Dans le même ordre d'idée,
ils favorisent les temps d'échanges au sein du
groupe.
Ainsi, les
outils utilisés au cours des ateliers sont en
évolution permanente : " les gens
écrivent leurs vies, ils se racontent".
C'est
d'ailleurs en connaissant les références des
participants (apprenants) que les formateurs
peuvent comprendre à quel stade de leur
apprentissage il y a blocage. Ici aussi c'est
dans la relation que ça va se passer ;
l'outil sera inefficace s'il n'est pas adapté
individuellement.
Métacognition :
comment apprend- on, retient-on…C'est cette
relation entre formateur et apprenant à côté
des cours stricto sensu d'alphabétisation qui
permet d'aider le formateur à trouver les
références de chacun pour apprendre, retenir.
-
Paulo
FREIRE 1921-1997- pédagogue brésilien.
Il est l'auteur d'une méthode
d'alphabétisation qui repose sur la
prise de conscience de sa condition
sociale par celui qui apprend.
Organisme
communautaire "l'École de la Vie"
Description de leur
intervention
1 - Objectif du projet
Agir
préventivement avec les familles (les parents
avec leurs enfants).
L'accueil
se fait en journée avec des enfants de 0 à 5
ans. L'accent ici aussi est mis sur l'importance
du groupe et la participation des apprenants.
Des
activités diversifiées sont proposées comme
les café rencontres dont l'objectif est de
donner du "répit aux parents", les
accompagner pour qu'ils se rencontrent,
s'entraident, profiter de ces rencontres pour
diffuser des informations sur la petite enfance
par exemple.
Promouvoir
les échanges au sein du groupe conduit aussi à
reconnaître les compétences de chacun.
Mise en
place d'ateliers lecture - écriture sur des
thématiques variées qui intéressent le groupe.
2 -
PUBLIC
35 femmes
de 20 à 40 ans.
3 -
Mode d'organisation
Entrées
et sorties permanentes sauf pour les groupes
d'alphabétisation et les remises à niveau qui
imposent un calendrier plus strict et
des groupes plus restreints de 8 à 10 personnes.
Quelques
éléments ayant retenu notre attention au cours
de nos rencontres
1) Le scolaire :
Financement des activités pédagogiques des
établissements scolaires de Montréal
Trois
éléments ont retenu notre attention :
Ø Une volonté
de transparence
-
utilisation
de critères objectifs, de ratios les
plus équitables possibles pour les
financements des divers établissements,
-
e
ratio se construit plus à partir de la
composition socio-économique du public
accueilli que sur les actions proposées
par l'école.
Ø Une
autonomie des établissements scolaires
-
les
écoles décident de ce qu'elles
priorisent grâce à ces financements
(frais de personnel supplémentaire,
frais de fonctionnement, matériel,
immobilier, …).
Ø Un appel à
des fonds privés
-
ce
procédé est courant pour cofinancer les
actions (par exemple : entreprises
pharmaceutiques, compagnie
d'électricité),
-
à ce
titre les entreprises concernées
intègrent les conseils d'administration
des établissements ; les bilans
d'actions doivent être précis, complets
et communiqués aux financeurs privés.
2) Le
périscolaire
Ici aussi
trois éléments ont retenu notre
attention :
-
les
interventions de ces structures dans le
milieu scolaire (exemple : le GIPEC
(Groupe d'Interventions Pédagogiques et
Communautaires) polyvalente Lucien PAGÉ,
le Programme d'Alternative au Décrochage
scolaire du Plateau de Mont-Royal),
-
la plate-forme
d'orientation des jeunes
décrocheurs scolaires (Centre
Métropolitain de Lutte au décrochage
scolaire),
-
les
moyens mis en oeuvre (locaux mis à
disposition par exemple).
3) Le sociétal
: l'importance du communautaire
-
elle
imprègne les modes d'organisation et les
réflexions jusque dans la mobilisation
des acteurs,
-
le
sentiment d'appartenance est développé
comme objectif prioritaire (exemple des
polyvalentes visitées, drapeau,
photographies d'enseignants et
d'élèves, cahier de texte de la
polyvalente Lucien Pagé),
-
les
interventions sont construites en
référence constante à la communauté
du quartier (l'appellation
"organisme communautaire" en
est d'ailleurs le premier indice ;
connexion avec les Centres Locaux
de Service Communautaire
équivalents de nos services sociaux).
4) Conclusion
En France
le mot "communautaire" a une teinte
négative (ghettos, replis) alors qu'au Québec
cette notion est l'outil de l'intervention
sociale ; elle imprègne l'interne des
établissements scolaires, ainsi que leurs
relations avec le milieu associatif d'une part et
le milieu entrepreneurial d'autre part.
5) Et
ensuite….
-
possible
journée de compte-rendu (commission
soutien scolaire et commission
parentalité du réseau associatif de la
Paillade - fonctionnement de l'éducation
nationale et congrès sur l'éducation
familiale),
-
suivi
des contacts auprès des personnes
rencontrées.
|